Climat de France par le roman

Extraits du roman " Le mensonge de Dieu" de Mohamed Benchicou, à paraître le 6 mai prochain et dont un des théâtres est la cité Climat de France d'Alger, où viennent de se dérouler les émeutes des 22 et 23 mars
M’écoutes-tu, mon verre de vin ?
Je suis le mendiant du cimetière et je vis d’oboles aléatoires.
Mais qui suivrait mon récit sans rougir de sa propre capitulation ?
Il règne toujours, ce soir, cet étrange tumulte. Les fans du Mouloudia d’Alger qui palabrent après le match… à moins que ce ne soient ceux de l’Usma… non, pas l’Usma… ici, dans la Cité bleue, c’est plutôt le Mouloudia….
Je suis le mendiant du cimetière et j’avais une histoire pour les hommes. Mais il n’était plus personne à qui la raconter.
Pour tout vous dire, je n’en suis guère surpris. Double Goulot me répétait que narrer votre histoire vous fabrique, à coup sûr, une armée d’ennemis, car les gens n’aiment pas qu’on leur rappelle leurs redditions. « La preuve : ton histoire, je n’y croirai pas puisqu’elle doit ressembler à la mienne ! » Tous les hommes solitaires et généreux que j’ai eu à connaître, Abdallah, Federico, Tahar Périgord, Chico le gitan, les combattants volontaires que j’ai côtoyés dans les tranchées de Barcelone et de l’Ebro, puis dans la Nueve, en Normandie, tous m’avaient tenu le même langage : « Il en sera toujours ainsi, camarade… ». C’est ce que me disait Oleg, le soldat ukrainien qui n’avait ni femme, ni enfant, ni mère, ni même une patrie, seulement la chienne Kyti. Il m’avait donné cette statuette d’indigène dans le repaire de Hitler à Berchtesgaden, ultime trace d’une vie passée à côtoyer les princes et les héros. Je l’ai appelé Heil Mouskeba, en souvenir d’une descendante d’esclaves de Rio de Oro que ma grand-mère avait pour gouvernante à Melilla.
Ce cahier blanc, je vous le laisserai, braves gens ! Qui sait ? Peut-être le lirez-vous…, à moins que vous ne le brûliez, allez savoir ! C’est mon toast d’adieu à cette existence que je quitte dans la bonne humeur, mon dernier pied-de-nez aux prophètes contrefacteurs, intronisés par le mensonge qu’ils ont fait dire à l’histoire et à Dieu ; mon ultime clin d’oeil à cette foule enfiévrée qui fait cohue ce soir et qui, en plus de ne pas savoir où elle va, a dû oublier d’où elle vient.
****
Je l’ai croisé hier, Samy, près du cimetière. C’était après l’heure des enterrements (...) Il a failli me reconnaître et j’ai dû remonter à la hâte ma capuche ! Il sortait d’un taxi et je l’avais identifié à temps. À quoi ? À son qamis immaculé, je crois. Ou à sa façon anxieuse de saluer le chauffeur. Peut-être même à son air faussement rassuré, celui qu’il avait enfant, quand il accompagnait sa mère Zoubida dans les rares visites qu’elle me faisait… Enfin, je ne sais plus !
Oui, par bonheur, il ne m’a pas reconnu.
« Cheikh, m’aurait-il demandé en suffoquant, comment es-tu devenu mendiant du cimetière, toi l’ancien guerrier, le doyen de la Cité bleue, cheikh Normandie, le patriarche vénérable, le vétéran d’Espagne et de Deir Yassine, le héros du débarquement de 1944 et des grandes apothéoses de ce siècle, le soldat de gloires, le libérateur de Paris et d’Alger ? »
Allez lui expliquer que sur cette terre on ne voit jamais venir la déchéance ! Mais, fils, dans cette communauté à la mémoire estropiée, ignorante de la moindre de ses épopées, dans cette patrie indifférente à la grandeur, à quelle honorabilité peuvent prétendre les héros de guerre ? Sache que nos guerres échouent toujours sur les berges arides du mensonge, du stupre et de la cupidité. Tu apprendras, mais il sera bien tard, tu apprendras que nos hommes mènent leurs guerres comme un bateau sans gouvernail : ils ne savent où ils vont. Ni même d’où ils viennent. Personne ne leur ayant raconté leur propre prestige, ils ne connaissent rien des rivages magiques du monde de leurs pères.
Oh oui, comme j’aimerais conter à Samy l’épisode, burlesque et tragique à la fois, de mon grand-père Belaïd revenu du front de Prusse pour s’enrôler imprudemment sous la bannière de Dieu avant d’être secouru par ses amantes, Agathe la blanchisseuse, Rosabelle l’Auvergnate, Torkia la favorite, Gertrude l’entremetteuse, Charlotte la paroissienne, Zhor la voyante, Augustine la musicienne… Ainsi fut-il écrit que ma dynastie serait parfois tentée par les derviches du jihad, mais toujours sauvée par des femmes providentielles.
M’écoutes-tu, mon verre de vin ?
Je suis le mendiant du cimetière et je vis d’oboles aléatoires.
Mais qui suivrait mon récit sans rougir de sa propre capitulation ?
****
Samy était interloqué. Son héros, le guerrier vénérable, son idole, cheikh Normandie, le doyen de la Cité bleue, le vétéran d’Espagne et de Deir Yassine, le héros du débarquement de 1944 et des grandes apothéoses de ce siècle, son héros n’est autre que le mendiant du cimetière !
Il se parlait à lui-même.
? C’était donc lui et j’avais failli le reconnaître… Comment se peut-il… ? Par quelle suprême conspiration le songe délirant d’un demi-siècle a-t-il fini en haillons ?
Il se prit le visage entre les mains.
? Ce jour-là, ce funeste jeudi de septembre, j’avais manqué de le reconnaître. Mais je ne voyais encore rien, je me barricadais contre les émotions humaines, c’est vrai ! Car jusqu’à cette semaine maudite, je n’étais rien d’autre, en effet, que le filleul égaré d’une filiation qui, d’ailleurs, m’était parfaitement méconnue.
Samy fixait de ses yeux rougis la ville désorientée. Il y faisait sombre. Sombre et froid.
? Non, je ne voyais rien. Il m’a fallu assister au crucifiement de ma propre chair, à l’immolation de Rafiq, à la démence de Kheïra, pour enfin prêter une oreille à cet appel, plus fort que l’appel de la raison, aussi fort que l’appel de Dieu : l’appel celui du sang, l’appel celui de l’enfance, la bourrasque tonique du souvenir ! Jusque-là, je l’avais toujours réprimé. Je m’étais barricadé contre les émotions humaines.
? Pourquoi ? s’étonna Roula.
? Oh, peut-être voulais-je seulement quitter mon milieu misérable et m’étais-je alors inventé un idéal, comme tant d’autres ; j’en ai vu tant partir comme ça : souvent, ils s’enrôlent pour échapper à la misère, mais la misère, ce n’est pas assez noble pour un homme. Alors, ils se convainquent d’avoir un idéal…
Puis il lâcha à voix basse :
? Je me barricadais contre les émotions humaines et il m’avait toujours manqué la voix de ma mère. Mais Zoubida, pieuse et seigneuriale, était muette. Heureusement, les vestiges de l’enfance m’ont toujours rattrapé. Comme ce jeudi de septembre où j’avais failli reconnaître le mendiant… J’avais rejoint la Cité bleue bien après l’heure des enterrements, j’étais en avance : l’imam nous attendait à 17 heures.
Une lueur nostalgique brilla dans ses yeux.
? Les seins de Aïcha m’accueillirent à l’entrée de la cité !
Aïcha-la-gouine ! On l’appelait ainsi parce qu’elle s’enfermait des journées entières avec des jeunes filles du lycée voisin et que, parfois, elle oubliait d’en sortir. On disait qu’elle racolait aussi dans le hammam, au salon de coiffure et chez Chahra, la cartomancienne. Sans doute est-ce vrai, puisqu’un soir la police l’embarqua sur suite à une plainte d’un parent d’une lycéenne et on ne revit plus Aïcha la gouine.
Elle avait laissé aux bonnes âmes le souvenir d’une femme dévergondée. Mais Samy − il avait alors 13 ans − n’en avait gardé que l’image de ses seins, ronds, fermes et agressifs. (...)
*****
Samy fut très tôt fasciné par la disposition des gens du quartier à traiter leur calvaire par l’ironie, « comme s’il n’était pas le leur ! ». Car, ici, dans ces favelas de béton, au milieu de la grande indigence, s’enseigne l’art de tout considérer avec une goguenarde philosophie. Tout : la vie, la mort, le passé, l’avenir, la patrie, les hommes, sa propre misère, surtout sa propre misère et, qui sait, peut-être même Dieu ! Il redoutait que derrière la faconde des adultes ne se cachât quelque inavouable atavisme, peut-être même une vieille inclination masochiste ou, allez savoir, un profond mépris de soi. Jusqu’au jour où il réalisa qu’il y avait un génie derrière l’autodérision.Quel talent, en effet, de pouvoir devenir étranger à sa propre déchéance ! Samy s’extasiait devant la savante formule des parias : piéger le malheur dans une espèce de virtualité pour mieux l’endurer !
Il se souvint que l’imam – qu’il agaçait parce qu’il subjuguait la pittoresque loquacité des habitants du ghetto – lui avait rétorqué que c’était une belle façon de prendre de la hauteur sur cette vie injuste, mais que ce n’était pas la meilleure.
Pourtant, le côté napolitain de son faubourg miséreux avait tout d’abord férocement envoûté Samy, comme au cinéma, avant de l’exaspérer. Il ne s’étonna d’ailleurs pas que le cinéma lui-même se déplaçât un matin dans son quartier sordide, avec ses caméras et ses éclairagistes, pour y filmer une populace en train de jouer son propre rôle. À ce qu’en a su Samy, l’œuvre magistrale qui sortit des bas-fonds de son enfance, un film au titre fantasque de Omar Gatlato, est resté le modèle inimitable de l’humour acide qu’enfantent les vies insupportables. Le succès du film ne le surprit pas. Où, diable, mieux qu’ici, sait-on mettre en scène sa propre détresse pour mieux la dépouiller de sa gravité ?
Les gens de la Cité bleue y confirmaient que la vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté, sont des champs de bataille qui ont leurs héros, héros obscurs parfois plus grands que les plus illustres.
El-Kettar ne se fatigue pas de rire de lui-même, de sa propre misère et, parfois même, de Dieu ! Telle est sa malédiction.
« Ils ont même mis ça en musique ! Au diable le luth et le chaâbi ! », s’était, une fois de plus, irrité l’imam de la mosquée un jour où l’on commémorait la mort de l’artiste éternel, Hadj El-Anka, dont la tombe perchée sur le cimetière d’El-Kettar domine l’humanité désorientée. « La musique amène la passivité, souvent la luxure, et la musique amène l’ignorance ! Et ils vivent dans la passivité, et ils vivent dans la luxure, et ils vivent dans l’ignorance. Ô gens de Bab El Oued, regardez-les expier de leur vivant. Ils ont eu la terre qui trembla sous leurs pieds, puis l’eau qui emporta leur progéniture et leurs maisons... »
C’est ainsi que les habitants d’El-Kettar surent que c’était Dieu lui-même qui les avait punis pour avoir choisi de railler leur sort plutôt que de s’en plaindre, ce jour du nouveau siècle où il les noya dans de terribles inondations qui engloutirent leur ghetto !
Mais qu’y pouvaient-ils… Quand tout dans leur misérable condition se prêtait à la boutade ? L’appellation d’El-Kettar elle-même invitait au sarcasme, elle qui désignait un quartier malodorant par le nom d’anciennes parfumeries.
? Si tu trouves aujourd’hui qu’El-Kettar pue, rappelle-toi qu’il fut jadis le haut lieu du bel arôme et qu’ici on distillait le jasmin pour en offrir le nectar aux dames d’Alger, rigolait le père de Samy, les soirs où il rentrait saoul.
Comment, en effet, ne pas rire encore et toujours de l’insoutenable désolation du quartier quand une étrange ironie du sort et un usage insidieux de la métaphore avaient osé le baptiser du joli nom de Climat de France ? Vivre à Climat de France, c’est pourtant habiter de miteuses cités surpeuplées, mais la litote fut définitivement adoptée pour ce qu’elle contribuait à théâtraliser le malheur. On vécut alors de pain sec et d’honorabilité ressuscitée, celle-là providentielle, qu’octroyait le prestige factice de l’enseigne trompeuse : « Je réside à Climat de France, près d’Alger. »
Le simulacre de l’écriteau masquant si parfaitement l’immonde réalité des ghettos, on en généralisa l’usage jusqu’à donner un nom poétique à chacune des « cités d’urgence », ces affreux baraquements en dur construits à la hâte par l’administration française pour y entasser les milliers d’indigènes que le dénuement poussait à penser aux armes.
C’est ainsi que sont nés « Les Gîtes du bonheur », sur les hauteurs de Belcourt, quartier d’enfance de la mère de Samy Zoubida qui y habita l’appartement de l’oncle Laïd, et la Cité bleue.
Samy y a vu le jour l’année d’une curieuse guerre arabe. L’année où mourut dans la lointaine Palestine, l’oncle Zouheir, le héros de la famille, le capitaine Zouheir Imeslayène.
Il la quitta l’année des Émeutes.
On appella ainsi l’année 1988 qui avait vu se soulever puis mourir, le tout en quelques heures, les adolescents de cette contrée accablée. Du haut du cimetière d’El-Kettar, ils surplombaient à leur tour la misère qui leur a survécu.
? Morts d’avoir refusé de rire de leur déchéance ! avait crié l’imam en guise d’épitaphe, un vendredi où Samy avait suivi ses amis dans la prière.
? Ou morts d’avoir voulu mener leur propre guerre ! avait rectifié le mendiant du cimetière.
Jusqu’à l’aube de ses quinze ans, Samy avait toujours partagé l’antique trois pièces avec son vieux père et ses deux jeunes sœurs, la providence s’étant, par bonheur, chargée de marier la plus grande, Kheïra, à qui l’appartement familial des Gîtes du bonheur, hérité de l’oncle Laïd, fut rétrocédé. La mère, Zoubida, la mère muette, était morte des suites d’une ancienne blessure, alors que Samy n’avait que dix ans. Le père ne s’en était jamais vraiment remis. Toutes les fois qu’il avait une poussée de nostalgie, on l’entendait qui marmonnait à lui-même : « Du temps de Zoubida… »
Rien évidemment, rien ne rappellait l’azur dans la Cité bleue. La mer était ailleurs, là-bas, derrière la ville et le ciel y est toujours gris. La Cité bleue, c’était juste une procession de façades sales qui serpentaient vers l’enfer. Un immense reptile de béton oublié des hommes, décoré de linge qui sèchait à longueur d’année, de paraboles qui aidaient à rêver d’une autre vie et de tags rouges : « Vive le Mouloudia ». Et comme rien ne rappelait l’azur dans la Cité bleue, les hommes d’ici l’ont rebaptisée « Diar El-Hnèche » , comme pour signifier son excès au simulacre poétique, réhabiliter le sobriquet populaire et montrer ainsi qu’ils rient d’eux-mêmes.
? Et quand tu douteras des bienfaits du colonialisme, rappelle-toi Diar El-Hnèche ! avait ricané son père un de ces soirs où l’alcool et le dépit invitaient au persiflage envers sa triste destinée.
Ce fut ce soir-là que Samy s’émancipa de sa pudeur filiale pour apostropher durement son géniteur :
? Il ne suffit pas de parodier son malheur pour y échapper, père ! Rire un instant, c’est bien, rire pendant un demi-siècle, c’est de la dérobade. On n’est plus au cinéma… Omar Gatlato, c’était il y a quinze ans ! Regarde-toi, regarde-nous ! Toi, avec ton ridicule tricot de corps puant l’alcool, résigné comme une salamandre, et nous à te regarder vieillir dans le malheur ! Le malheur, il faut l’affronter par la force et l’aide de Dieu… La force, tu m’entends ? La force et Dieu. Les jeunes vont encore agir, père, mais cette fois-ci, ce ne sera pas pour juste casser des vitrines !
Le père, interloqué, en vait perdu la voix. Il se trouvait, il est vrai, un peu ridicule dans son tricot de corps. D’une voix chevrotante et pâteuse, il avait opposé toutefois une parade dérisoire :
? Et que veux-tu dire par salamandre ?
Samy lui avait déjà tourné le dos.
Le père regarda, impuissant, l’enfant qu’il n’avait pas vu grandir lui claquer la porte au nez. Il comprit que son fils s’en allait pour toujours et feignit de ne pas s’en émouvoir.
? Il ne sert à rien de pleurer, Kheïra, avait-il répondu à la grande sœur éplorée. L'existence, c'est comme ça. Tu fais des gosses et tu attends qu'ils s'en aillent. Et puis, quand ils sont partis, tu attends qu'ils reviennent.
Souvent, le père répétait à la cantonade : « À quinze ans, moi, je nourrissais déjà mes frères ! Quinze ans, c’est l’âge de partir ! ». Il était toujours solennel mais jamais très fier de son piètre argument : « Quinze ans, c’est l’âge de partir. Mais pour aller où ? », finissait-il par s’interroger les soirs où l’alcool réveillait l’angoisse paternelle.
Oui, mon Dieu, vers où part-on à quinze ans, quand on n’a pas encore trouvé de prétexte pour vivre et qu’on croit avoir toutes les raisons de mourir ?
Le père mourut l’hiver d’après sans avoir jamais su la réponse. Le vieil Algérois s’en était allé rejoindre les hauteurs qu’il avait caressées toute sa vie… Il était arrivé au bout de son numéro. Il allait enfin retrouver la considération dans la culminance bénite du cimetière d’El-Kettar et, du haut de sa sépulture, il pourrait enfin ricaner à loisir du spectacle des hommes se prenant au sérieux.
Extraits du roman "Le mensonge de Dieu" de Mohamed Benchicou - A paraître le 6 mai 2011







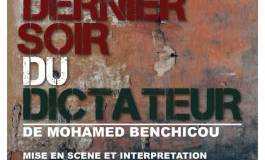


Commentaires (0) | Réagir ?