Boussad Ouadi : "Les canaux de diffusion du livre ont été asséchés"

Éditeur-libraire, Bousad Ouadi ne cesse de tirer la sonnette d’alarme sur la décrépitude que vit le monde des libraires, de l’édition et de la culture d’une manière générale.
Vous êtes gérant de deux librairies les plus anciennes d’Alger, celle des Beaux Arts, rue Didouche Mourad et la librairie ex-Dominique rue Charras. De l’avis même de ses acteurs, les libraries sont menacées de fermeture. Est-ce un constat vrai ? Si oui, quelles en sont les causes ?
Boussad Ouadi : Bien sûr que c’est vrai nous avons une baisse d’activités dans la rue Charras et c’est un peu moins grave à la librairie des Beaux-arts car la rue Didouche Mourad est passante. Mais, globalement, toutes les librairies, à l’intérieur du pays, comme à Alger, connaissent depuis décembre 2010 une baisse dramatique de leur chiffre d’affaire. Les causes sont multiples. Certaines sont conjoncturelles : l’actualité politique, les gens sont préoccupés par le pouvoir d’achat, la situation sécuritaire. En ce qui me concerne, j’en vois deux essentielles : l’une, c’est la situation économique catastrophique et dramatique dans laquelle nous a mis le pouvoir en imposant toutes ces restrictions à l’importation du livre qui nous frappe de plein fouet : l’imposition du crédit documentaire pour les importations de livres, les contraintes bureaucratiques douanières, ont découragé les importateurs. Le commerce du livre est très peu capitalistique. En tant qu’importateur, je n’ai pas importé de livres depuis trois ans à cause de cette loi scélérate. Nous sommes tenus de payer les livres commandés avant même qu’ils ne partent de l’étranger. Il faut attendre ensuite trois mois pour qu’ils parviennent en librairie. Or, partout ailleurs dans le monde, le commerce du livre se fait exactement à l’inverse : les éditeurs prennent le risque de publier un livre ; ils les confient aux diffuseurs et libraires pour les vendre et ces derniers les paient trois ou quatre mois après, avec faculté de retour. Je peux renvoyer les livres invendus qui me sont défalqués de la facture d’achat. C’est de cette manière que le libraire peut vivre. L’activité du libraire vit sur le crédit fournisseur et non sur une rente. Car, l’activité intellectuelle n’a pas besoin d’argent. Notre richesse c’est notre patrimoine, notre savoir, la diffusion du savoir. La deuxième raison tient à la crise qui frappe l’université aujourd’hui. Mes deux librairies sont à deux pas de la Faculté centrale d’Alger et l’essentiel de leurs activités se fait avec les étudiants et les professeurs. Or, bien que les profs aient vu leurs salaires augmenter de manière significative, ils se détournent de la librairie. Ils ont d’autres sollicitations, vers l’automobile ou l’immobilier. Avec de petits salaires, ils fouinaient dans les librairies, cherchaient à se cultiver, fréquentaient les musées et salles d’expo. La situation sécuritaire en est un autre facteur. Les gens n’osent plus venir au centre ville, fuyant les embouteillages et les matraquages ces quatre derniers mois. Voilà à mon avis les principales raisons du déclin des activités de librairie, du moins dans la capitale. Il y a peut-être une troisième raison quelque peu anecdotique : les éditeurs locaux qui sont devenus des sous-traitants pour le compte des budgets de l’Etat, du ministère de la culture, ne vivent que d’événements, de festivals, d’années spéciales, d’années de l’Islam, Arabe, donc ils ne produisent plus. Tout ce qu’ils éditent, ils le livrent au Ministère de la culture et ils se détournent de la librairie. Ils ne se préoccupent pas de savoir de quoi a besoin le lecteur, les livres qu’il faut publier. Non, ils se complaisent à obéir aux commandes du Ministère de la culture. Ils ne se préoccupent aucunement de la demande sociale. Le commerce du livre passe par-dessus la librairie. Les budgets attribués aux universités passent également par-dessus nos têtes. Les universités ne commandent pas les livres en librairie alors qu’avant, la BU (Bibliothèque universitaire) avait, tous les mois, son quota en librairie. Depuis deux années maintenant, je n’ai pas vu un sou de la BU de la Fac centrale entrer dans mes librairies. Les universités de Blida, de Sétif et d’autres ne s’en approvisionnent plus du tout chez nous; elles passent par de petites officines obscures, le copinage et le clientélisme. La librairie se meurt. Et, tout cela ne préoccupe personne.
Les deux librairies que vous exploitez ont chacune un passé mythique. Pouvez-vous nous en parler ? Pour quelles raisons les librairies actuelles n’ont plus ce profil ?
C’est plus des mythes que des réalités. Honnêtement, ce n’est pas cela qui fait le commerce. Une librairie c’est avant tout sa capacité à satisfaire une demande de lecture. Les gens ne vont pas venir dans telle librairie parce qu’elle a reçu dans le temps Albert Camus ou Jean Paul Sartre. Oui, ça rajoute un peu à la notoriété, mais cela n’est possible que quand il y a de l’activité, quand on satisfait notre clientèle. Or, 80% des demandes ne sont pas satisfaites. Notre activité a été brisée par les acteurs officiels de la culture. Nous passons notre temps à dire aux gens « makach… »
Certaines librairies qui ont multiplié des rencontres, des conférences et des ventes-dédicaces ont du mettre la clé sous le paillasson…
Toutes ces activités ne constituent pas la vocation d’une librairie. On a confondu l’agitation culturelle et le véritable travail du libraire. De même pour la Bibliothèque nationale ; on en a fait un lieu de rencontres. Ce n’est pas sa vocation. La sienne propre, devrait être la bibliophilie, la conservation des manuscrits, des ouvrages de spécialités, de recherche etc… L’animation est du ressort des centres culturels. La librairie aussi n’a pas vocation à organiser des débats, des vernissages,- accessoirement, oui – mais l’objectif d’une librairie est d’abord de servir la demande en lecture des gens, avoir des rayonnages bien fournis, des livres adaptés à la demande du quartier, et de la clientèle. C’est ainsi que les vocations se perdent. On vit dans une société artificielle où on ne sait plus qui est quoi et qui fait quoi…La librairie est un Book Shop. Les Anglais ont le meilleur terme « book shop » et ils le distinguent de « library » (Bibliothèque) qui sont des institutions prestigieuses en Angleterre. Souvent d’ailleurs la librairie chez nous, c’est « maktaba » elle est confondue à la bibliothèque. Or, je le répète, nous sommes des bookshop, des vendeurs de livres. Et d’ailleurs des bibliothèques dignes de ce nom, il n’y en a plus. Il y a des médiathèques, juste pour la presse et quelques rossignols qui traînent mais il n’y a pas ou très peu de livres. On a tué la bibliothèque, le service de lecture publique, tout comme on a entravé le libre commerce du livre. Les canaux de diffusion du livre ont été asséchés par les politiques stériles, fumeuses de nos dirigeants qui veulent tout ramener à la politique de « service des princes », des paillettes et festivals. Ils gaspillent des budgets colossaux dans des manifestations qui n’ont aucun sens culturel et des publications vides de sens. Au lieu de mettre tous ces budgets pour réaliser des encyclopédies, des ouvrages de références, d’érudition, au lieu d’encourager la création, de financer des livres qui ne sont pas commerciaux, (poésie, philosophie, essais littéraires…), au lieu de promouvoir le savoir, la culture, on finance la danse du ventre, des pacotilles et de vieilles photos de nostalgie de la période coloniale. Des stupidités. La société est verrouillée, enfermée dans l’ignorance et la méconnaissance et tout cela va favoriser toutes sortes de dérives.
Après la disparition progressive des librairies d’Etat, nous assistons ces dernières années à des fermetures de librairies privées. Vous-même étiez exposé à ce problème. A qui incombe la responsabilité ? Quels en sont les causes ?
Oui, bien sûr. Rien qu’à Alger centre, Mille feuilles Ibn Khaldoun, Espace Noun ont fermé, El Ghazali avant. Pour quelles raisons ? L’arnaque : la revente par les anciens de l’entreprise d’Etat ENAL à vil prix les fonds de commerce qui avaient vocation à être des libraires. Le personnel a revendu cela à des marchands de chaussures, de vêtements ;..etc. C’est un détournement inacceptable du patrimoine immobilier de l’Etat, une dilapidation au nom de la spéculation immobilière. Aujourd’hui, ces mêmes fonds de commerce valent le double, voire le triple… Et bien sûr, ce n’est pas la culture qui va pouvoir concurrencer de telles pratiques ! Et ça va aller en s’aggravant. C’est une démission des pouvoirs publics. Un détournement de la fonction de l’État dans des activités illégales, obscures et parallèles pour servir des clientèles. Mais, c’est partout pareil. Il n’y a plus de production locale. On n’a plus besoin de culture de science et de savoir, pas besoin des métiers du livre. On n’est plus des acteurs, des créateurs, des producteurs, on n’est plus des citoyens actifs qui revendiquent, qui consomment, se battent et construisent une société de solidarité, de production .
Quel est alors le rôle du syndicat des libraires ( Aslia) ?
Inconnu au bataillon. ASLIA est une histoire mort-née. Pourtant j’en suis membre fondateur. Elle n’a vécu que le mirage des trois mois de sa création. Dès sa naissance, elle a été investie par des lobbies qui voulaient caporaliser la profession et la mettre au service de l’ANEP, SEDIA, Hachette. Hachette et Sedia ayant disparu, leurs sous-traitants locaux ont bradé les librairies de l’Etat et continuent encore à utiliser le sigle ASLIA pour se faire financer par les ambassades et les services culturels étrangers pour des voyages à l’étranger, les Salons… C’est honteux.
Les prix dits des « libraires » étaient décernés en dehors de toute structure d’ASLIA, dans des cafés, des bars, dans un système de copinage. C’est encore et toujours les mêmes lobbies de Hachette, Sedia, Alpha, des milieux d’affaires internationaux qui ont gangréné notre profession avec la complicité du pouvoir politique algérien. J’ai toujours dénoncé ces lobbies. A quoi sert d’attribuer des prix littéraires dans un pays où on fait tout pour tuer la création. Les prix n’ont de sens qui si, à la base, les fondations existent, s’il y a une vie littéraire, des revues, des publications, des débats, des échanges. Or, rien de tel chez nous.
Les libraires ne sont pas autorisés à commercialiser le livre scolaire qui reste le monopole de l’Éducation nationale ? Quel est votre avis là-dessus ? Quelles sont les explications fournies ?
C’est le plus gros scandale dans notre métier. Partout dans le monde, les deux mamelles du commerce du livre sont l’école et la religion. Près de 100 millions de livres scolaires publiés chaque année nous passent sous le nez. On n’a pas le droit de les commercialiser. A l’époque du Président Liamine Zeroual (1994-95) nous avions mené, en tant qu’association des éditeurs, des négociations avec l’ONPS ( Office National des Publications Scolaires). Des lois ont été édictées, un règlement a été adopté pour l’homologation des livres scolaires. Puis ce fut un flop. Hachette, Sedia et Nathan , tous les éditeurs français commençaient à flasher sur le marché algérien. S’y sont introduits deux ou trois éditeurs locaux, qui, à l’époque étaient petits, Casbah, Chihab, Sedia, Libris. Ils ont obtenu quelques miettes, pas négatives du tout car avec 5 ou six titres tirés à quelques millions d’exemplaires , vous pouvez dormir tranquille ! C’est le même lobby au niveau de l’Etat qui maintient le commerce du livre dans une opacité scandaleuse . Pourquoi sont-ce les établissements scolaires qui vendent des livres. Ce n’est pas du tout leur vocation. J’ai conduit moi-même les négociations avec le PDG de l’ONPS (2007/2008), actuellement directeur du cabinet du ministre de l’Education. Il partageait l’avis selon lequel il était nécessaire de faire participer les librairies à la diffusion du manuel scolaire, que cela allégeait les structures de l’Etat, rapprochait le livre du lecteur, créait des emplois, nourrissait des familles. Mais au bout d’un certain temps, les autorités sont finalement restées dans les vieilles méthodes. Aujourd’hui les parents d’élèves se plaignent qu’il n’y ait pas de manuels dans les classes alors qu’ils croupissent en stocks à l’ONPS, c’est un scandale innommable. A côté de ce gâchis, nos librairies restent vides. Malika Greffou avait lancé un pavé dans la mare avec la publication aux éditions Laphomic de son essai : L’école algérienne, d’Ibn Badis à Pavlov ( Malika Boudalia Greffou, préface de Mohammed Djidjelli, Laphomic, Alger, 1989, NDLR). Avec force exemples, elle disait qu’on ne pouvait avoir une « pédagogie nationale », la pédagogie est, comme d’autres disciplines, est une science. Elle est universelle. Et comme sciences, elle a des applications différentes, adaptées, aux conditions du public. D’où l’idée que le manuel scolaire n’est pas unique et imposé et que l’enseignant, l’inspecteur, l’élève devraient avoir le choix des manuels scolaires. Et dans une telle optique, la librairie deviendrait un lieu de vie, inséparable du milieu scolaire. Mais notre système politique ne permet pas cette dynamique…
Entretien réalisé par R.M
Documents
Observatoire des Politiques Culturelles en Afrique
Rapport pour l'Observatoire des Politiques Culturelles en Afrique (OCPA)-2009
Projet de Recherche sur les Politiques Culturelles des Communautés Locales et Régionales
LA POLITIQUE CULTURELLE DANS LA VILLE D’ALGER (Extrait)
Ammar Kessab
LA POLITIQUE CULTURELLE DANS LA VILLE D’ALGER
L’UNESCO définit la politique culturelle comme « l’ensemble des usages et de l’action ou absence d’action pratiqués consciemment et délibérément, dans une société, destinés à satisfaire certains besoins culturels par l’utilisation optimale de toutes les ressources matérielles et humaines se trouvant à la disposition de cette société à un moment donné » [UNESCO, dans F. Colbert, 1992]. En d’autres termes, la politique culturelle est un instrument aux mains des pouvoirs publics qu’ils utilisent pour préserver les composantes identitaires du peuple. L’investissement dans les expressions culturelles par leur diffusion dans le cadre d’activités culturelles et artistiques est la matérialisation d’une politique culturelle nationale ou territoriale.
Les différentes autorités publiques dans la ville d’Alger ont, dès l’indépendance du pays, oeuvré pour renouer avec les vrais repères culturels de la capitale, occultés pendant longtemps par la colonisation.
La doctrine socialiste qui prédominait entre 1962 et 1990 orientait la politique culturelle du pays vers le nationalisme révolutionnaire arabe et panafricain. Alger en était le berceau à travers l’organisation de manifestations culturelles géantes et dont le Festival culturel panafricain d’Alger en était le meilleur exemple. Cet événement d’envergure internationale marque jusqu’à nos jours les esprits. Organisé comme une réponse au Festival mondial des arts nègres de Dakar (FESMAN, 1966), il avait fait d’Alger, le temps des festivités, « une Afrique miniature » regroupant la majorité des expressions artistiques et littéraires que le continent noir pouvait contenir. Mais le Festival Panafricain d’Alger avait surtout rassemblé toutes les forces révolutionnaires, non seulement du continent africain mais du monde entier. A l’époque, l’Algérie et les mouvements révolutionnaires ne se reconnaissaient pas dans le courant de la « négritude » prêché dans le contient par le président sénégalais Léopold Sédar Senghor, jugé trop complaisant avec les anciennes puissances coloniales.
En 1988, les émeutes populaires ouvrent la porte au multipartisme et à l’économie de marché. Entre 1990 et 2000, une grande insécurité met l’ensemble des instituions culturelles à l’agonie : salles de cinéma laisser à l’abandon ou céder à des privés pour usage non culturel (de 56 salles avant 1962 dans la ville d’Alger à moins d’une dizaine en 2000) ; fermeture du Théâtre National Algérien entre 1994 et 2000, etc.
Les pouvoirs publics avaient d’autres priorités : garantir la sécurité du citoyen.
En l’an 2000, Alger est entrée dans une nouvelle phase : avec l’amélioration de la situation sécuritaire et la stabilisation de l’économie nationale, une dynamique culturelle est enclenchée. Plusieurs structures culturelles rouvrent leurs portes et une dizaine de grands projets ambitieux sont lancés. Alger panse ses plaies et s’ouvre sur le monde. Aujourd’hui, la ville connaît un foisonnement culturel et artistique salutaire.
« Alger, capitale culturelle du monde Arabe » a marqué en 2007 le retour de la ville sur le plan régionale Arabe. Le ministère de la Culture a mobilisé pour l’occasion des moyens humains et financiers considérables. On retiendra de cette manifestation la réalisation d’une soixantaine de films, la publication de 1001 livres, la production de 45 pièces de théâtre, la création du musée d’arts moderne d’Alger, du musée de la miniature, d’enluminure et de calligraphie...
Pour rappeler aussi son attachement et son appartenance au continent noir, Alger organisera en 2009 le deuxième Festival culturel panafricain d’Alger, soit quarante ans après la première édition. Notons que la même année, Dakar accueillera pour la deuxième fois sur son sol le FESMAN. Hasard ou concurrence, l’histoire nous le dira.
Comme pour l’événement « Alger, capital culturelle du monde Arabe », le ministère de la Culture a consacré pour le Festival Panafricain d’Alger des moyens financiers importants : 75 millions de dollars. Un village artistique a été construit pour accueillir 2500 artistes africains [Ministère Algérien de la Culture, 2008]
La raison pour laquelle Alger se retrouvait – et se retrouve toujours – au devant de la scène en tant que territoire de la concrétisation de la politique culturelle nationale, est due à la conception jacobine de l’Etat algérien. De nos jours, la capitale concentre à elle seule la majorité des institutions culturelles du pays et l’essentiel des événements artistiques.
Trois autorités publiques partagent le secteur de l’activité culturelle. Ces instances exercent leur pouvoir de politique culturelle à travers des organismes plus ou moins indépendants d’elles, ou à travers une mise sous tutelle directe des établissements culturels publics.
Le ministère de la Culture, première autorité publique du pays, exerce son pouvoir de politique culturelle à travers la Direction de la culture de la Wilaya d’Alger, l’Office National de la Culture et de l’Information (ONCI), L’Office Riadh el Feth (OREF) et aussi à travers un ensemble d’autres structures et organismes culturels publics mis sous tutelle directe.
La Wilaya d’Alger, autorité régionale, inclue la Commission des affaires culturelles de la Wilaya d’Alger et l’Etablissement Arts et Culture.
Les assemblées populaires communales (APC) appelées aussi Communes, sont dotées de Services culturels, et pour le cas de l’APC d’Alger Centre, de l’Office de Promotion Culturelle et Artistique (OPCA).
Précisions que quatre centres culturels étrangers travaillent activement à Alger : le Centre culturel français, l’Institut Goethe (ambassade d’Allemagne), l’Institut Cervantès (ambassade d’Espagne), le Centre culturel italien. Ces quatre centres culturels n’ont pas autre objectif que celui de représenter la culture de leur pays à travers les diverses expressions artistiques programmées à l’intérieur de ces centres, mais aussi parfois dans des salles de spectacle extérieures. Ces organismes ne se permettent pas, au nom du respect de la souveraineté du pays d’accueil, d’avoir une stratégie qui va au-delà de la simple offre culturelle diplomatique. Ainsi, leur champ d’action sort de la « politique culturelle » comme définit par l’UNESCO. C’est pour cette raison qu’ils ne feront pas partie, avec les initiatives privées, du schéma de la construction de la politique culturelle locale menée par les autorités publiques.
Vu la multitude des concepteurs de la politique culturelle à Alger, il serait tout à fait plausible dans ce cas de parler de « politique culturelle dans la ville d’Alger » ou de « politiques culturelles de la ville d’Alger ».
Nous présenterons dans ce qui va suivre ces autorités publiques, leurs missions, les rapports qu’elles entretiennent entre elles ainsi que les infrastructures qu’elles gèrent.
LE MINISTERE DE LA CULTURE
En 2005, le gouvernement décide de consacrer un ministère à la seule culture après que celle-ci ait partagé pendant une décennie un ministère avec la communication. Les missions du nouveau ministre de la Culture sont définies par le décret exécutif n° 05-79 du 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la Culture. L’évaluation des moyens financiers et matériels du secteur est l’un des missions des plus importantes.
Le budget de la culture en Algérie n’atteint pas le 1 % du budget national préconisé par l’UNESCO. Cependant, et depuis 2005, il ne cesse d’accroître. Le tableau suivant permet de constater cette évolution positive dans le temps [Journal officiel, 2003-2008] :
L’analyse permet de constater qu’entre 2005 et 2006, le budget de la culture a connu un accroissement de 59,47 %, représentant de ce fait 0,38 % du budget de l’Etat.
En 2008, il est de 123 325 408 USD (8 276 873 000 DA), soit 0,52 % du budget général de l’Etat. Il a augmenté de 57,08 % par rapport à l’année 2007. Ce budget est le plus important consacré à la culture depuis l’indépendance. Ceci demeure vrai si on ne prend pas en compte le budget global de l’année 2007 qui avait atteint la montant historique de 158 292 473 USD (10 769 191 000 DA) mais qui incluait le fond spécial débloqué par le gouvernement à l’occasion de la manifestation « Alger capital culturelle du monde arabe » et qui s’élevait à lui seul à 80 842 526 USD (5 500 000 000 DA).
Le budget de la culture 2008 est supérieur de presque 40 % à celui de 2003, pourtant la culture et la communication à cette époque partageaient un budget commun. Il atteint presque 1 % du budget de l’Etat de 2003.
Cette brève analyse du budget consacré à la culture permet de considérer la puissance croissante de cette autorité publique dont le siège est établi à Alger.
Sources : http://www.alger-culture.com/news.php?readmore=64







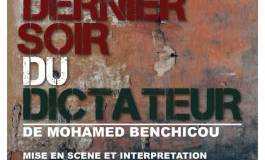


Commentaires (2) | Réagir ?
J'aimerai juste rebondir sur le sujet de la distribution du livre scolaire. L'Etat algérien se déchargeant du monopoile de l'édition et de la distribution du livre scolaire (comme cela se fait partout dans le monde, excepté au beylicat d'Alger) c'est un peu comme si les détenteurs du monopole sur l"'import - import" se désaisissent de "leur" poule aux oeufs d'or.
En d'autre termes, ce serait la fin de la bétise comme fondement de l'éducation nationale. Par extension, ce serait la fin de la bétise comme idéologie officielle unique en Algérie dans 10 - 15 ans.
On construira une pizzeria à la place. Je vous l'avais bien dis que l'Algérien en général est un tube digestif.